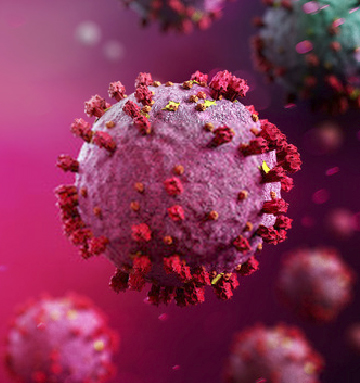Morsure de serpents venimeux
Situation dans le monde
Les morsures des serpents constituent un problème de santé publique malheureusement négligé dans de nombreux pays des régions tropicales et subtropicales. Chaque année, il se produit 5,4 millions de morsures de serpents entraînant de 1,8 à 2,7 millions de cas d’envenimation (intoxication par une morsure de serpent). On compte entre 81 410 et 137 880 décès et environ 3 fois plus d’amputations et d’incapacités définitives chaque année.
La plupart des cas surviennent en Afrique, en Asie et en Amérique latine. En Asie, jusqu’à 2 millions de personnes sont mordues par des serpents venimeux chaque année tandis qu’en Afrique, on estime entre 435 000 et 580 000 le nombre de morsures nécessitant un traitement. Ce sont les femmes, les enfants et les agriculteurs dans les communautés rurales pauvres des pays à revenu faible ou intermédiaire qui sont le plus souvent victimes d’une envenimation. Ce fardeau pèse le plus lourd sur les pays ayant de faibles systèmes de santé et peu de ressources médicales.
Les morsures de serpents venimeux sont des urgences médicales. Elles peuvent entraîner des paralysies sévères susceptibles de bloquer la respiration, des troubles sanguins pouvant aboutir à des hémorragies fatales, des insuffisances rénales irréversibles et des destructions tissulaires locales sévères susceptibles de provoquer des incapacités définitives et l’amputation d’un membre. Leurs conséquences sont plus sévères chez l’enfant en raison d'une masse corporelle plus faible
On peut éviter la plupart des décès et des conséquences sérieuses en généralisant la disponibilité des sérums antivenimeux. Des sérums de qualité sont le seul traitement efficace pour éviter ou supprimer la plupart des effets toxiques des morsures de serpents. Ils devraient faire partie du minimum de soins de santé primaires à prodiguer en cas de morsure.
Une production de sérums antivenimeux difficile
L’un des grands défis pour la fabrication des sérums antivenimeux est de préparer l’agent immunogène (le venin de serpent) qui convient. De plus, l’insuffisance des moyens réglementaires de contrôle des sérums antivenimeux, dans les pays où le problème des morsures des serpents est important, entraîne une incapacité d’évaluer la qualité et l’adaptation des sérums.
Une mauvaise estimation des besoins parallèlement à la déficience de politique de distribution ont poussé les fabricants à augmenter les prix des sérums voire à en arrêter la production.
Systèmes de santé faibles et données insuffisantes
Dans de nombreux pays où les morsures de serpents sont fréquentes, les systèmes de santé ne disposent pas des infrastructures et des ressources pour collecter des données statistiques solides sur ce problème. L’évaluation du véritable impact se complique d’autant plus que le nombre des cas notifiés aux ministères de la santé par les cliniques et les hôpitaux ne représente en fait qu’une faible proportion de la charge de morbidité réelle : de nombreuses victimes n’arrivent jamais dans les établissements de soins de santé primaires et ne sont donc pas enregistrées. Certains facteurs socio-économiques et culturels contribuent à cette situation en influant sur le comportement des victimes pour se faire soigner, nombre d’entre elles préférant les soins traditionnels à ceux des hôpitaux.
L’insuffisance des données sur les morsures de serpents, en quantité comme en qualité, a des répercussions sur la disponibilité des sérums antivenimeux. Il en résulte en effet une sous-estimation des besoins par les autorités sanitaires nationales, une faible demande aux fabricants pour la production des sérums et la mise en place de stratégies d’achats et de distribution inadaptées dans les pays.
Production faible de sérums antivenimeux
Compte tenu de la faible demande, plusieurs fabricants ont cessé la production. Pour certains sérums, on a assisté à une augmentation spectaculaire des prix au cours des 20 dernières années et les traitements sont devenus inabordables pour la majorité de ceux qui en ont besoin. Cette hausse des prix a encore fait baisser la demande, à tel point que ces traitements sont en déclin sensible ou ont même disparu dans certaines régions.
Nombreux sont ceux qui pensent qu’en l’absence de mesures fortes et décisives prises rapidement, la rupture d’approvisionnement en sérums antivenimeux est imminente en Afrique et dans certains pays d’Asie.
Action de l’OMS
L’OMS a pris des mesures pour sensibiliser les autorités sanitaires et les responsables politiques à ce problème. Suite à une demande de plusieurs États Membres des Nations Unies, l’OMS a officiellement inscrit en juin 2017 l’envenimation dans la liste des maladies tropicales négligées prioritaires.
L'Organisation prie les responsables de la réglementation, les producteurs, les chercheurs, les cliniciens, les autorités sanitaires nationales et régionales, les organisations internationales et communautaires de collaborer pour améliorer la collecte de données épidémiologiques fiables sur les morsures de serpents, le contrôle réglementaire des sérums antivenimeux et les politiques de distribution.
Conduite à tenir en cas de morsure de serpent ?
En attendant les secours qu’on a pris soin d’informer, il est recommandé de :
- Rassurer la victime ;
- Mettre la victime au calme ;
- La placer en position latérale de sécurité si elle perd connaissance ;
- Enlever tout ce qui pourrait entraver le gonflement de la zone mordue ;
- Immobiliser le membre mordu ;
- Si possible désinfecter la plaie à l’aide d’un antiseptique ;
- En cas de douleur, utiliser uniquement du paracétamol.
A l’inverse, certaines conduites ne doivent jamais être réalisées après une morsure de serpent :
- Ne jamais poser de garrot, ni de bandage compressif ;
- Ne jamais sucer la plaie ;
- Ne jamais l’inciser ni la cautériser ;
- Ne jamais appliquer de glace ou de pommade ;
- Ne jamais utiliser de kits anti-venins car ils sont inefficaces
Les signes de gravité d’une morsure de serpent
Tous les serpents ne sont pas venimeux et dans la moitié des cas, le serpent venimeux n’injecte pas de venin au moment de la morsure. Les spécialistes distinguent donc deux cas de morsures de serpent venimeux :
- Les morsures sèches, bénignes, car elles n’entraînent que des symptômes locaux ;
- L’envenimation, plus grave, entraînant des symptômes généraux plus ou moins intenses selon la dose de venin injectée.
En général, les envenimations ne provoquent que des symptômes généraux légers, sauf lorsque la personne mordue est allergique à un composant du venin. La réaction allergique peut induire des symptômes cutanés, des troubles respiratoires, des signes cardiovasculaires, voire une confusion ou un choc anaphylactique pouvant mettre en jeu le pronostic vital.
Prévention des morsures de serpent
Les serpents, venimeux ou non, fuient l’Homme en règle générale. La morsure est une réaction de défense face au danger. Quelques petits conseils peuvent être utiles afin de limiter les désagréments d’une morsure :
- Ne pas marcher pieds nus lors d’une balade dans la nature, mais porter des chaussures fermées, montantes si possible et des pantalons genre jeans ;
- Eviter de se promener seul et toujours emmener son téléphone ;
- Faire attention où l’on marche et ce que l’on touche, en particulier quand il fait chaud, dans les herbes hautes, à l’approche de buissons, dans les cailloux, etc. ;
- Ne pas chercher à tuer ou à toucher un serpent (même s’il semble mort) mais se retirer sans l’effrayer ;
- Eviter de soulever du bois, de grosses pierres ;
- Vérifier l’absence de serpent avant de s’installer pour une pause dans la nature ;
- Préférer les chemins tracés et ne pas s’en écarter.
A Kédougou, les espèces venimeuses sont essentiellement représentées par des vipères. Ce sont des serpents à tête triangulaire. Pendant la période de chaleur (mars, avril, mai, juin), il n'est pas rare de trouver des serpents dans les habitations en quête de fraîcheur.
Conseils santé
mes contact

Les médicaments génériques…
Selon la définition juridique, un médicament générique est une copie. Textuellement, reprenant la définition de 1981, “un médicament générique est une copie de médicament dont la production et la commercialisation sont possibles par l’obtention du brevet dans le domaine public. Celle-ci intervient une fois écoulée la période légale de protection”.
D’après l'Académie Nationale de Pharmacie de Paris, un médicament générique est un médicament qui a la même composition en qualité et en quantité en principes actifs et la même forme pharmaceutique, “dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées". Avec plus de précisions, le docteur Jean-Paul Tillement (membre de l'Académie) dira que c’est : “un médicament qui délivre la même dose de principe actif et dans les mêmes conditions de vitesse que le médicament princeps”. L’avantage des médicaments génériques est leur coût. Normal, la molécule ayant été identifiée l’autorisation de mise sur le marché( A.M.M.) coûte moins cher et le prix de vente du médicament devient ainsi plus compressible. D’après des études aux Etats Unis, le prix est approximativement de 30 % inférieur à celui du médicament original. Il arrive très souvent que le laboratoire auteur du princeps aligne ses prix avec celui du générique.
La génération
Aussi bien pour les professionnels que les consommateurs, il n’est pas évident de connaître un médicament sous plusieurs noms. Au Sénégal, une loi a été votée en 1999 autorisant les pharmaciens à proposer une substitution. Les professionnels ont le pouvoir de proposer un générique à la place de la molécule princeps prescrite par le médecin. Mais ceci n’est possible que si le médecin et le patient sont d’accord. Au cas contraire, le médecin prescripteur peut toujours mentionner sur l’ordonnance “Ne pas Substituer”. Cette note interdit formellement le remplacement par un générique. Il faut cependant noter que les patients ne sont pas très réceptifs à la substitution de médicaments. Cela se remarque surtout auprès des personnes âgées qui refusent de prendre un médicament avec un nom différent de celui prescrit. L'ignorance en est probablement la raison.
Y a t-il des médicaments dont le princeps n’est pas substituable?
“Oui”, répond un pharmacien interrogé par Doctissimo. Il précise, “la non-substitution intervient dans des cas très particuliers, lorsque les médicaments ont une marge de sécurité (rapport entre la dose toxique et la dose active) très faible". Au pharmacien de poursuivre, “dans ces cas et uniquement dans ces cas, la nécessité d'être précis sur la dose est telle qu'il vaut mieux ne pas faire courir le moindre risque au patient.”
Il y a deux cas dans lesquelles, la substitution est très compliquée, voire difficile : chez les patients souffrants d'épilepsie ou de l'insuffisance thyroïdienne. "Quand une épilepsie ou une insuffisance thyroïdienne sont parfaitement équilibrées, on ne change pas le médicament : si c'est un princeps, on garde ce princeps, et si c'est un générique, on garde ce générique et on ne le remplace pas par un autre", explique le Docteur Tillement.
Le médicament générique est-il soumis aux mêmes contrôles que le princeps?
Evidemment, comme tout médicament, le générique fait l’objet d’une demande d’autorisation avant sa mise sur le marché. Sans quoi, il ne pourra pas être commercialisé. Le laboratoire demandeur de l'autorisation doit déposer son dossier mais peut, “s'affranchir de fournir de nouvelles données de sécurité et d'efficacité de son médicament générique et faire référence aux études réalisées pour l'AMM du médicament dont il est la copie, si et seulement s'il a démontré la bioéquivalence entre les deux médicaments. Il est donc dispensé des études cliniques mais doit s'astreindre à des études de bioéquivalence”. Après cela, c’est aux autorités de AMM d'évaluer et de décider de la validation.
Pourquoi le générique est moins cher ?
Parce qu’à la mise sur le marché d’un médicament, celui-ci est protégé par un brevet d’exclusivité de 20 ans. Une fois cette période écoulée, le secret de fabrication de ce médicament devient public. Les autres laboratoires pharmaceutiques peuvent fabriquer le même médicament et le proposer. Puisque les recherches ont déjà été faites, les laboratoires ne dépensent pas grand-chose d’où le faible prix par rapport à l’original.

Comment conserver les médicaments?
Les médicaments doivent être conservés dans une pièce à température ambiante. Ils doivent aussi être à l’abri de la lumière et de l’humidité tout en évitant la chaleur. Toutefois, prenez en compte que le mode de conservation peut différer d’un médicament à un autre. Prenez toujours et avant tout le temps de bien lire la notice d’utilisation qui renseigne sur la date de péremption, les conditions de conservation etc...
1/ La date de péremption : Elle est toujours écrite sur le carton de l’emballage du remède. Très habituellement, elle est présentée sous forme “Mois/ année”. Il est très important d’avoir cette information pour la conservation de votre médicament. Elle est notifiée par le fabricant du produit. Au delà de cette date, le médicament n’est plus garanti et le fabricant dégage toute responsabilité quant aux effets indésirables pouvant survenir suite à son utilisation. La consigne est d'éviter d’utiliser les médicaments dont la date de péremption est dépassée.
2/ Où garder ses médicaments ? : Les médicaments doivent être conservés dans les conditions répondant à certains critères :
*Un endroit sec, à l’abri de l'humidité
*Sans contact directe avec lumière, interdit d’exposer au soleil
*Eviter de garder dans un endroit à chaleur forte
*Pas à portée des enfants ni des animaux
Ainsi, il est conseillé d’éviter les endroits comme la salle de bain, la voiture, la cuisine ou à côté de la fenêtre.
Températures conseillés pour conserver les médicaments
*entre 2 °C et 8 °C (donc au réfrigérateur);
*entre 15 °C et 30 °C (donc à température ambiante), parfois à une température maximale de 25 °C;
*entre 4 °C et 30 °C (au réfrigérateur ou à température ambiante).
Il faut garder à l’esprit qu’il ne sert à rien de mettre son médicament au réfrigérateur si ce n’est pas demandé par le fabricant. Rappelez-vous également que la date de péremption ne s’applique que pour les médicaments étant conservé dans le paquet d’origine. Si vous changez le conteneur d’origine d’autres normes peuvent s’appliquer.
Exemple:
| Forme pharmaceutique | Date de péremption |
| Capsules et comprimés | 3 à 5 ans |
| Crèmes et onguent entubé | 1 à 2 ans |
| Crèmes et onguents transvasés | 90 jours |
| Médicaments injectables | Durée variable |
| Gouttes ou onguents pour les yeux | 15 à 30 jours |
Quelques conseils:
Conservez si possible vos médicaments dans leur conteneur d’origine
Evitez de mélanger plusieurs médicaments dans un seul conteneur
Ne prenez jamais un médicament dont le goût, l’aspect ont changé entre deux utilisation
Eviter l'automédication
Vous avez une petite pharmacie à la maison. Faites y régulièrement le ménage
Ne laissez pas traîner les médicaments dont la date de péremption est dépassée.

La Pharmacie
réseau sociaux du site
Telephone
Tél : +221 33 985 15 25 / 78 597 56 56

Un personnel qualifié et compétent
Pour vous rendre un service de qualité, nous sélectionnons rigoureusement le personnel selon un processus visant à tester le savoir faire.

Une attention particulière à chaque client
Parce que chaque client est unique, nos clients méritent chacun une attention particulière.